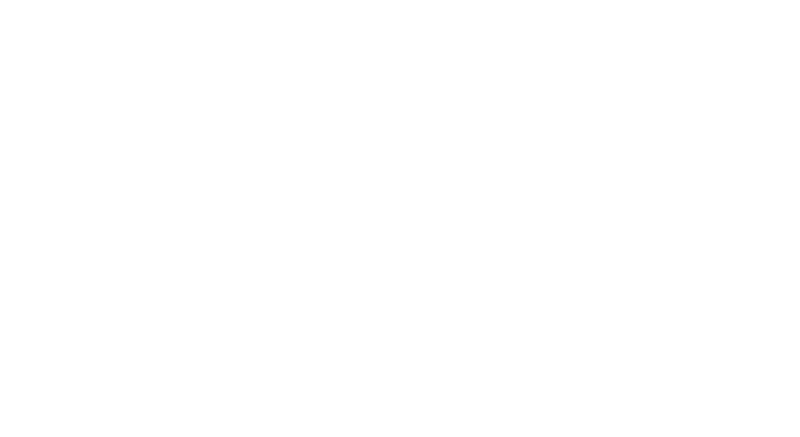Alban Bensa : « La Nouvelle Calédonie au cœur de sa propre histoire »
« À propos de la Guerre kanak de 1917 en Nouvelle-Calédonie. Pour une anthropologie historique, politique et dialogique »
Alban BENSA (anthropologue, EHESS)
MFJ, 7 juin 2016
(en français, à partir de 5’30)
Modération : Sylvie Beaud (anthropologue, MFJ)
La guerre qui sévit en Europe et aux portes de l’Asie entre août 1914 et novembre 1918 offrit bien des opportunités inattendues. En divers endroits de la planète, de nombreuses populations malmenées par les entreprises coloniales occidentales cherchèrent à tirer profit de cette situation nouvelle. La France eut à faire face, au tournant 1917, à des mouvements indigènes contestant son autorité. En Nouvelle-Calédonie, la guerre contre la force coloniale, qui couvait déjà depuis plusieurs années, éclata sur la côte ouest de la Grande Terre. Elle fit 300 morts sur une aire qui comptait tout au plus 6 000 personnes, et laissa des traces profondes dont la situation actuelle est toujours l’héritière. C’est de cette guerre dont nous parlerons, en évoquant sa mémoire dans la culture kanak.
Car il existe une histoire kanak de la Guerre de 1917 et de la Nouvelle-Calédonie. Dans une sorte de chœur dont les partitions sont le fait de lettrés kanak, dans des récits, poésies, chants, sont convoquées des voix qui composent ensemble un même chant général que nous pourrions baptiser « chant de la décolonisation de la Nouvelle-Calédonie ». Cette histoire est savante en ce qu’elle s’appuie sur la mémoire et les archives, littéraire puisqu’elle reconnaît au verbe poétique une capacité de contribuer à la connaissance, et explicitement politique parce qu’elle vient défier l’histoire élaborée par les Blancs. Elle la défie sur le plan des faits et de leur véracité. Quantité d’événements de la Guerre de 1917 se sont en effet ancrés dans le souvenir kanak sans figurer pour autant dans les archives militaires et judiciaires.
En assumant leur idéal politique au cœur même de leur travail de mémoire historique, les Kanak montrent que la science aussi est relative aux pouvoirs qui la portent. Dès lors, afin de rééquilibrer les conceptions du passé, fallait-il que s’impose un savoir trop longtemps assujetti aux visées de la colonisation. Cette conférence présentera ce dossier et tentera de dégager les attendus méthodologiques et les conséquences théoriques d’une anthropologie résolument critique et contemporaine.